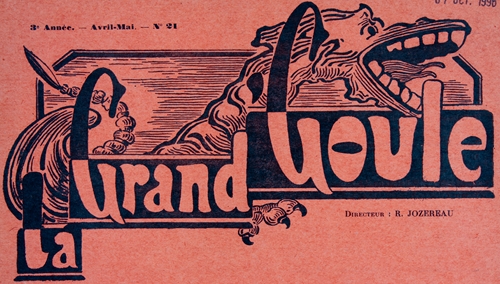Animal & Monstres
précédentsuivantLa Grand’Goule de Poitiers
Jean Gargot, la Grand’Goule, 1677
Collection Musée de la Ville de Poitiers et de la... Afficher la suite de la légende
Jean Gargot, la Grand’Goule, 1677
Collection Musée de la Ville de Poitiers et de la Société des Antiquaires de l’Ouest, D909.2.1 © Musées de Poitiers/Christian Vignaud
Jean Gargot, la Grand’Goule, 1677
Collection Musée de la Ville de Poitiers et de la Société des Antiquaires de l’Ouest, D909.2.1 © Musées de Poitiers/Christian Vignaud
En-tête de la revue La Grand Goule
La Grand'goule. - Poitiers : 1931 (Poitiers, Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, 271592)
Jean Gargot, la Grand’Goule, 1677
Collection Musée de la Ville de Poitiers et de la Société des Antiquaires de l’Ouest, D909.2.1 © Musées de Poitiers/Christian Vignaud
Animal fantastique représenté sous la forme d’un dragon ailé, la Grand’Goule tient une place privilégiée dans l’imaginaire et le bestiaire poitevins. La tradition populaire l’associe généralement au culte de sainte Radegonde (v. 519-587). La bête aurait vécu au VIe siècle dans les eaux du Clain et dévorait toutes les sœurs qui s’aventuraient dans les souterrains de l’abbaye Sainte-Croix. La sainte aurait alors combattu l’animal à l’aide d’une croix, d’eau bénite et de prières.
En réalité, sans que l’on sache exactement à quand remonte cette légende, les origines - probablement païennes - et l’histoire de la Grand’Goule restent encore obscures, de même que celles de toutes les figures monstrueuses de ce genre (Tarasque de Tarascon, Gras-ouilli de Metz, gargouille de Rouen, guivre de Milan, etc). Les premières mentions textuelles attestées proviennent du XVe siècle. Dans deux actes datés de 1466 et 1496, on apprend que le mardi et le mercredi des Rogations (les trois jours précédant l’Ascension), les chanoines de Sainte-Radegonde portent en procession dans toute la ville plusieurs objets de l’abbaye Sainte-Croix, dont une bannière précisément appelée le Dragon. Cette manifestation est une des plus populaires de la ville jusqu’à la Révolution. Si bien qu’en 1677, à la demande des sœurs de l’abbaye Sainte-Croix, Jean Gargot (maître-sculpteur à Poitiers ayant vécu entre 1655 et 1691) réalise une sculpture de la Goule en bois polychrome (L. 1,85 m, l. 0,77 m, h. 0,57 m) à porter en procession au bout d’un long bâton. Cette œuvre, aujourd’hui conservée au Musée Sainte-Croix, est le seul témoignage visuel connu parvenu jusqu’à nous. Le corps de l’animal, entièrement annelé, est doté d’ailes de chauve-souris, d’une épine dorsale, de deux pattes ressemblant à des serres d’aigles et d’une longue queue terminée en pince de scorpion dentelée. Sa tête est pourvue de gros yeux enfoncés, d’une gueule grande ouverte munie de multiples dents pointues, d’un bec d’aigle et d’une longue langue à l’extrémité fourchue.
La Grand’Goule d’abord considérée comme l’image de la victoire du Christ sur le Mal devient, au fil des siècles, l’un des objets les plus vénérés lors des processions. La bête est en effet décorée de banderoles de tissus de couleurs diverses, sa queue de rosettes et on jette dans sa gueule des cerises et des pâtisseries poitevines appelée casse-museaux. Les femmes frottaient leur chapelet contre son corps en criant « Bonne sainte veurmine (venant de « vermine » nom donné à tous les animaux venimeux), priez pour nous ». Figure protectrice et symbole de Poitiers, la Grand’Goule a depuis donné son nom à une revue littéraire poitevine, dont elle illustre l’en-tête de 1929 à 1934, et à une discothèque de la ville. Utilisée à des fins publicitaires, comme pour le logo de la mutuelle du Poitou, elle est également l’emblème du Stade poitevin.
Animal fantastique représenté sous la forme d’un dragon ailé, la Grand’Goule tient une place privilégiée dans l’imaginaire et le bestiaire poitevins.
On l’associe généralement au culte de sainte Radegonde. La tradition populaire a retenu que la bête aurait vécu au VIe siècle dans les eaux du Clain et dévorait toutes les sœurs qui s’aventuraient dans les souterrains de l’abbaye Sainte-Croix (à Poitiers). Sainte Radegonde aurait alors combattu l’animal à l’aide d’une croix, d’eau bénite et de prières.
En réalité, on ne sait pas à quand remonte cette légende. Les origines et l’histoire de la Grand’Goule restent encore obscures.
Les premières mentions proviennent de la fin du XVe siècle. On sait qu’à cette époque, 3 jours avant la fête chrétienne de l’Ascension, les chanoines de Sainte-Radegonde portent en procession dans toute la ville plusieurs objets de l’abbaye Sainte-Croix, dont une bannière précisément appelée le Dragon. Cette manifestation est très populaire jusqu’à la Révolution, si bien qu’en 1677, à la demande des sœurs de l’abbaye Sainte-Croix, Jean Gargot (maître-sculpteur) réalise une sculpture de la Goule en bois polychrome (avec plusieurs couleurs) pour qu’elle soit portée en procession au bout d’un long bâton. Cette œuvre est conservée au Musée Sainte-Croix.
Le corps de l’animal, entièrement en anneaux, comporte des ailes de chauve-souris, une épine dorsale, deux pattes ressemblant à des serres d’aigles et une longue queue terminée en pince de scorpion dentelée. Sa tête est pourvue de gros yeux enfoncés, d’une gueule grande ouverte munie de multiples dents pointues, d’un bec d’aigle et d’une longue langue à l’extrémité fourchue.
La Grand’Goule d’abord considérée comme l’image de la victoire du Christ sur le Mal devient, au fil des siècles, l’un des objets les plus vénérés lors des processions. La bête est en effet décorée de banderoles de tissus de couleurs diverses, sa queue de rosettes et on jette dans sa gueule des cerises et des pâtisseries poitevines appelée casse-museaux. Les femmes frottaient leur chapelet contre son corps en criant « Bonne sainte veurmine (venant de « vermine » nom donné à tous les animaux venimeux), priez pour nous ».
Elle est aussi une figure protectrice laïque et un symbole de Poitiers.
Pascale Brudy
Bibliographie :
Bellin de La Liborlière (Léon-François-Marie), Vieux souvenirs de Poitiers d’avant 1789, Poitiers, 1846, p. 131, 137-209
Bellin de La Liborlière (Léon-François-Marie), « Appendice à l’article sur la Grand’Gueule », dans Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1847, p. 8-18
Rédet (Louis), « Un épisode des processions des Rogations à Poitiers en 1466 », dans Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest, t. VIII, 1856-1858, p. 210-218
Barbier de Montault (Xavier), « Le trésor de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers avant la Révolution », dans Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, 1881, p. 228-248
Briand (Emile), Histoire de Sainte Radegonde, Poitiers-Paris, 1898, p. 395-398
Favreau (Robert), « Histoire de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers », dans Mémoires de la Société des Antiquaires de l’Ouest, t. XIX, 1986, p. 195 et 355
Favreau (Robert), « Le culte de Sainte Radegonde à Poitiers au Moyen Âge », dans Les religieuses dans le cloître et dans le monde, Saint-Etienne, Publications de l'Université de Saint-Etienne, 1994, p. 101-102
Mineau (Robert), Racinoux (Lucien), La Vienne légendaire et mythologique : être fabuleux, mythes anciens, légendes historiques et hagiographiques, Poitiers, 1995-2000 (1978), p. 134-137