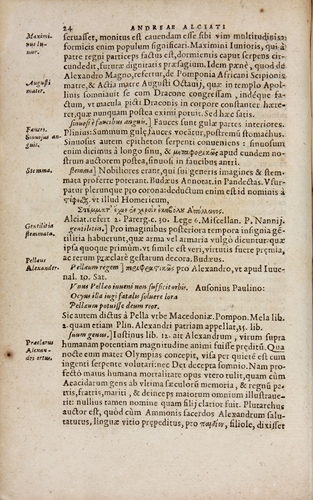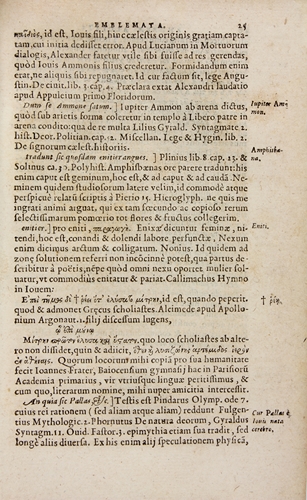Animal & Identité
précédentsuivantAnimal et légende héraldique : La guivre des Visconti
La guivre du duc de Milan
Les souverains du monde... Tome IV.- Paris : Guill... Afficher la suite de la légende
La guivre du duc de Milan
Les souverains du monde... Tome IV.- Paris : Guillaume Cavelier, 1718 (Poitiers, Bibliothèque universitaire, Fonds ancien, 43882)
Description des armoiries des Visconti à la page 211 dans un traité de Claude-François Menestrier.
Le veritable art du blason et l'origine des armoiries / Claude-François Menestrier.- Lyon : T. Amaulry, 1675 (Poitiers, Bibliothèque universitaire, Fonds ancien, 70795)
Une guivre
La nouvelle méthode raisonnée du blason... / Claude-François Menestrier.- Nouvelle éd. - Lyon : Ponthus, 1761 (Poitiers, Bibliothèque universitaire, Fonds ancien, 70796)
Claude-François Ménestrier mettait régulièrement en cause les légendes héraldiques, qui pour lui n'étaient pas crédibles : il attaquait principalement celles qui se déroulaient avant le XIe siècle, car il avait compris que les armoiries n'existaient pas auparavant.
La guivre du duché de Milan
Recueil de planches de l’Encyclopédie par ordre de matières. Tome septième. – Paris : Panckoucke ; Liège : Plomteux, 1789 (Poitiers, Bibliothèque universitaire, Fonds ancien, m 205442-07)
La guivre du duché de Milan dans les Emblèmes d’Alciat et son commentaire
Emblemata… / André Alciat - Paris : Jérôme de Marnef et Veuve Guillaume Cavellat, 1583 (Poitiers, Bibliothèque universitaire, Fonds ancien, XVI 688)
La Légende héraldique, récit sur la création des armoiries
À la fin du Moyen Âge, les raisons qui avaient conduit des individus à choisir certaines figures pour leurs armoiries – créées depuis les XIIe-XIIIe siècles – étaient tombées dans l'oubli. C'est pour cette raison que les familles, parfois aidées des hérauts d'armes, ont créé et diffusé des légendes racontant comment, suite à un événement particulier, un ancêtre avait décidé de placer telle ou telle figure sur son écu. Ces légendes héraldiques, exaltant la gloire familiale, ont ainsi permis de rehausser le prestige de ces lignages et de légitimer leurs ambitions politiques à une époque où l'autorité royale tendait à se renforcer.
Les animaux, figurant dans la plupart des armoiries du Moyen Âge, se retrouvent naturellement dans les légendes qui expliquaient leur présence dans l'écu. Le rôle qu'ils jouaient dans le récit, qu'il fût passif ou actif, dépendait souvent de l'image qui leur était associée dans les mentalités de l'époque et du sens symbolique que l'on voulait donner au récit, ce qui pouvait évoluer avec le temps. Mais, à partir de la Renaissance, grâce au développement de l'esprit critique, ces légendes furent de plus en plus contestées par certains, alors que d'autres continuaient d'y croire et de les diffuser.
Les différentes légendes sur la guivre des Visconti
Les armoiries de la famille Visconti, ducs de Milan, comportaient une figure très originale : un serpent aux allures de dragon appelé guivre dévorant ou vomissant un personnage rouge. Cette figure a peut-être été adoptée car les Visconti possédaient le titre de seigneur d'Angera, nom se rapprochant du mot latin anguis, signifiant serpent. Il se peut également que ce motif s’inspire des représentations paléochrétiennes assez nombreuses en Lombardie du Cetus, le monstre biblique dont on fera plus tard une baleine, vomissant Jonas. La présence de cette guivre a donné naissance à au moins trois récits, dans lesquels le rôle de l'animal n'est jamais le même.
Au XIVe siècle, Pétrarque a écrit l'histoire d'un chevalier nommé Azo, parti en campagne militaire dans les Apennins. Un jour, voulant se reposer, il ôta son casque pour s'allonger sur le sol. Mais alors qu'il était endormi, un serpent se glissa à l'intérieur. Sans se rendre compte de la présence de l'animal, il remit le casque sur sa tête et le serpent retomba le long de sa joue sans chercher à le mordre. C'est en souvenir de ce signe de bon augure qu'il aurait choisi la figure de cet animal pour ses armoiries. Le serpent est ici considéré de façon réaliste, tel qu'il existe dans la nature.
Dans ses Mémoires datant de la fin du XVe siècle, Olivier de La Marche décrit l'aventure de Boniface, comte de Pavie marié à l'héritière de Milan. Alors qu'il était parti en croisade contre les Musulmans, un « serpent de merveilleuse grandeur » terrorisa la Lombardie et tua son fils. Une fois revenu, Boniface retrouva cette « beste » qui emportait alors un enfant dans sa gueule. Après un combat acharné au cours duquel la tête du serpent se renouait une fois coupée, le chevalier finit par tuer l'animal. C'est en la mémoire de ce combat que ses enfants prirent l'emblème d'un serpent avec un enfant dans sa gueule. L'animal est ici imaginaire, représenté comme géant, tel un dragon.
Au XVIe siècle, Paul Jove et André Alciat situèrent la légende en Terre Sainte, pendant la première croisade. Othon, vicomte de Milan, aurait, pendant le siège de Jérusalem, combattu un redoutable Sarrasin, un géant nommé Volux. Ce dernier portait sur son casque un cimier représentant un serpent dévorant un enfant, afin d'effrayer ses ennemis. Ayant obtenu la victoire, Othon aurait alors repris le cimier en signe de trophée et placé la figure du serpent sur son écu. Dans cette légende, le serpent apparaît déjà comme un élément emblématique : le cimier.
Le serpent de Milan a donc été représenté de manières différentes, soit en animal réel, en animal imaginaire ou en animal emblématique. Dans les trois cas, son aspect négatif et dangereux reste toujours présent. Les auteurs de l'époque moderne ont repris ces différentes versions, critiquant celles qui leur paraissaient peu crédibles et choisissant les plus réalistes. Par exemple au XVIIe siècle, Marc de Vulson, citant le texte d'Olivier de La Marche, n'a pas hésité à dire que « les impertinences de ceste narration estans trop visibles et apparentes, nous ne prendrons pas la peine de les refuter », préférant plutôt les deux autres. Malgré leur volonté de se rapprocher de la vérité historique au sujet de l'origine réelle des armoiries familiales, ils ont participé à la diffusion de ces légendes, en ne favorisant que les plus réalistes.
La légende héraldique, récit sur la création des armoiries
À la fin du Moyen Âge, les raisons qui avaient conduit des individus à choisir certaines figures pour leurs armoiries – créées depuis les XII-XIIIe siècles – étaient tombées dans l'oubli. C'est pour cette raison que les familles ont créé et diffusé des légendes racontant comment, suite à un événement particulier, un ancêtre avait décidé de placer telle ou telle figure sur son écu. Ces légendes héraldiques, exaltant la gloire familiale, ont ainsi permis de rehausser le prestige de ces lignages et de justifier leurs ambitions politiques à une époque où l'autorité royale tendait à se renforcer.
Les animaux, figurant dans la plupart des armoiries du Moyen Âge, se retrouvent naturellement dans les légendes qui expliquaient leur présence dans l'écu. Le rôle qu'ils jouaient dans le récit dépendait souvent de l'image qui leur était associée dans les mentalités et du sens symbolique que l'on voulait donner au récit, ce qui pouvait évoluer avec le temps. Mais, à partir de la Renaissance, ces légendes furent de plus en plus contestées.
Les différentes légendes sur la guivre des Visconti
Les armoiries de la famille Visconti, ducs de Milan (Italie), comportaient une figure très originale : un serpent aux allures de dragon, appelé guivre, dévorant ou vomissant un personnage rouge. Cette figure a peut-être été adoptée car les Visconti possédaient le titre de seigneur d'Angera, nom se rapprochant du mot latin anguis, signifiant serpent. La présence de cette guivre a donné naissance à au moins trois récits, dans lesquels le rôle de l'animal n'est jamais le même.
Le serpent de Milan a été représenté de manières différentes : en animal réel, en animal imaginaire ou en animal emblématique. Dans les trois cas, son aspect négatif et dangereux reste toujours présent.
Les 3 légendes
Un jour, le chevalier Azo, fatigué de la guerre, voulant se reposer, ôta son casque pour s'allonger sur le sol. Mais alors qu'il dort, un serpent se glisse à l'intérieur. Sans se rendre compte de la présence de l'animal, il remet son casque sur sa tête et le serpent retombe le long de sa joue sans chercher à le mordre. C'est en souvenir de ce signe positif qu'il aurait choisi la figure de cet animal pour ses armoiries. Le serpent est ici considéré de façon réaliste, tel qu'il existe dans la nature.
Le comte de Pavie est marié à l'héritière de Milan. Alors qu’il est parti en croisade contre les musulmans, un « serpent de merveilleuse grandeur » tue son fils. Une fois revenu, Boniface retrouve cette beste qui emportait alors un enfant dans sa gueule. Après un combat acharné au cours duquel la tête du serpent se renouait une fois coupée, le chevalier fini par tuer l'animal. C'est en la mémoire de ce combat que ses enfants prirent l'emblème d'un serpent avec un enfant dans sa gueule. L'animal est ici imaginaire, représenté comme géant, tel un dragon.
Othon, vicomte de Milan, aurait, pendant une croisade, combattu un redoutable Sarrasin, un géant nommé Volux qui portait sur son casque un cimier représentant un serpent dévorant un enfant, afin d'effrayer ses ennemis. Ayant obtenu la victoire, Othon aurait alors repris le cimier en signe de trophée, et placé la figure du serpent sur son écu. Dans cette légende, le serpent apparaît déjà comme un élément emblématique : le cimier.
Nicolas Fromentin
Bibliographie :
Duerloo (Luc), « Transcending the frontiers of reality : the significance of heraldic legends », dans Genealogica et Heraldica. Proceedings of the 22nd International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences on Ottawa, August 18-23, 1996, Ottawa, Les presses de l'Université d'Ottawa, 1998, p. 349-356
Fromentin (Nicolas), Les légendes héraldiques : Création et utilisation des légendes sur les origines des armoiries dans l'Europe des XIVe-XVIIe siècles, mémoire de Master 1 sous la dir. de Laurent Hablot, Poitiers, 2011
Pastoureau (Michel), Traité d'héraldique, Paris, Picard, 1979